Vercors - Les animaux dénaturés
Vercors, Jean Bruller, rendu célèbre par son récit Le Silence de la mer (1942) sur la relation patrimoniale entre un Allemand et un foyer français pendant la guerre et la frontière humaine entre les Hommes, publie dix ans plus tard Les animaux dénaturés, un récit qui pose des questions philosophiques afin de conduire le lecteur à s’interroger sur sa propre nature. Les intérêts de ce roman sont multiples ; ils tiennent aux genres auxquels on peut rattacher l’œuvre ainsi qu’à la réflexion qu’elle induit.

Œuvre multiforme, Les animaux dénaturés se présente d’emblée comme un récit policier ; tous les éléments du genre y sont produits : le personnage principal, Douglas Templemore, un journaliste, est un assassin. Son crime ? Il a commis un infanticide. La victime ? Son fils, un nouveau-né mort depuis peu, un Paranthropus erectus. L’arme du crime est un poison : le chlorhydrate de strychnine. Le livre s’ouvre sur une enquête que l’inspecteur Brown, détective fantoche, va prendre en charge à l’aide des remarques avisées du médecin légiste, le docteur Figgins. Dès lors, c'est le mobile qui nous intéresse : pourquoi D. Templemore a-t-il tué son fils ? L’interrogatoire fait rapidement émerger la question de la nature de la victime et de sa mère : sont-ils humains ? L’enfant ressemble en effet, plus à un singe qu’à un petit d’homme ; d’ailleurs, l’épouse de Templemore n’est pas la mère de la victime. De fait, on l’aura compris, l’intrigue n’est pas policière puisque dès le début tous les éléments susceptibles de créer du suspense sont dévoilés ; le lecteur n’a donc que le mobile à élucider ; c'est d’ailleurs, ce qu’indique le chapeau placé en titre du premier chapitre (« Qui s’ouvre selon les règles par la découverte d’un cadavre, d’ailleurs très petit, mais déconcertant »). En réalité, il s’agit davantage de circonstances dont il faut comprendre le sens, l’enjeu.
Pour amener le lecteur à le découvrir, le récit procède à un retour dans le passé lors d’un voyage entrepris vers la Nouvelle-Guinée : une équipe de paléontologues composée du couple Greame et du géologue Kreps ainsi que du père bénédictin Pop Dillinghan, part chercher le « chaînon manquant » ; leur route évoque les récits de voyages et d’aventures à la façon de L’Ile au trésor (1881) de Robert Louis Stevenson, ou de L’Ile mystérieuse (1874) de Jules Verne, ou encore de l’Ile du Docteur Moreau (1896) de H. G. Wells ; les explorateurs quittent Sougaraï, circulent dans la forêt accompagnés de porteurs papous, se dirige à l’aide d’un sextant, se perdent au pied d’une falaise impraticable, et découvrent un os pariétal hors du commun, celui d’une créature entre l’homme et le singe – c'est la preuve du « chaînon manquant » — ; or, cet os est récent ce qui paraît incroyable mais qui l’est moins que la rencontre des créatures elles-mêmes, des « fossiles vivants ». Comme dans un récit de voyages, l’objet de la découverte est comparé à ce que le lecteur connaît afin qu’il se le représente : leur visage est « nu comme celui des humains », leur nez est « écrasé comme celui des singes », leurs lèvres sont « comme celles des gorilles », ils ont des « dents puissantes avec des canines comme des crocs » ; à l’instar des récits de voyages, le narrateur-personnage qui tient son journal de bord sous forme de lettres envoyées à son aimée, manifeste une progression dans sa réflexion au fur et à mesure qu’il en apprend plus sur le sujet ; toutefois, on ne peut réduire le récit aux voyages qui n’occupent qu’un tiers des chapitres du roman ; de plus, si, comme dans les récits de voyages et d’aventures, la découverte d’une nouveauté (un nouveau monde, une nouvelle espèce) peut faire évoluer le personnage principal du point de vue moral, on voit bien vite que la volonté du récit n’est pas tant centrée sur ce personnage que sur les interrogations du lecteur vis-à-vis de la question de l’humanité.
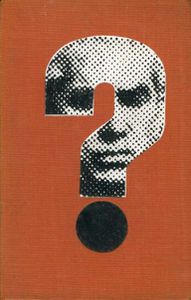
C'est la découverte d’êtres surnaturels, êtres hybrides entre l’homme et le singe, qui prépare ces interrogations de même que dans La Planète des Singes (1963) de Pierre Boulle ; l’invention d’un « chaînon manquant » vivant a de quoi surprendre ; cependant, leur existence ne crée pas pour autant un univers fantastique car elle n’est pas remise en question par les scientifiques ; elle n’est pas non plus source de peur, malgré l’apparence effrayante des hommes-singes – leur comportement paisible a tôt fait de les assimiler à des créatures pacifiques voire dociles. Le récit est bien ancré dans la réalité du début à la fin ; il oscille entre Londres et la Nouvelle-Guinée ; les questions qu’il soulève font référence aux découvertes et théories scientifiques encore valables aujourd’hui, de Darwin, Lamarck, Locke, Benveniste qui étayent la réflexion des personnages et opposent l’orthogenèse au créationnisme du père Dillighan. Leurs arguments seront d’ailleurs repris lors du procès auquel D. Templemore sera assigné. A la manière des scientifiques, les créatures découvertes sont baptisées d’un nouveau nom ; on parle d’abord de Paranthropus Greamiensis du nom des paléontologues Greame, puis de Parenthropus erectus sur le modèle de l’Homo erectus, finalement de Tropis, mot-valise construit sur l’association d’« anthropos » (homme) et de « pithêkos » (singe). Le roman s’ancre dans notre quotidien parce qu’il prend certes en compte le domaine scientifique mais politique, économique, et religieux également. L’effet de réalité est légèrement terni lorsque Frances, la compagne de D. Templemore fait remarquer que les lettres qu’ils échangent entre Londres et les confins de la forêt où il se trouve, doivent nécessairement parvenir à destination bien qu’elle ne s’explique pas comment, encore que souligner cette absence de précision confère au récit un caractère réel par la volonté de crédibilité. Autre effet de réalité : la langue anglaise qui situe le lieu principal de l’action, et met en relief l’appartenance des protagonistes à la culture britannique.
Dans le courant des années 1940-1950, où le livre de Vercors a été écrit et édité, roman de la Libération, la littérature française connaît une influence de l’anglais ; à la manière de Vernon Sullivan (Boris Vian) dans J'irai cracher sur vos tombes (1946) ou Elles se rendent pas compte (1950), ou de R. Queneau dans Le Journal intime de Sally Mara (1950), le roman de Vercors se rapproche par son ton et son style, des romans « à l’américaine » ; mais, les expressions idiomatiques comme « Damn ! », « What the devil ! » auxquelles Vercors a recours ont surtout vocation à parodier les romans policiers anglais (comme le faisait Boris Vian) parus depuis les années 1930 – bien que le genre policier soit ensuite abandonné à l’issue du premier chapitre. Outre les anglicismes, c'est surtout l’humour anglais qu’il paraît important de souligner ; malgré des sujets sérieux (un crime, une réflexion philosophique sur la nature humaine, l’esclavage et le racisme), le lecteur ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire devant la caractérisation satirique des personnages qui en relève les mimiques grotesques : le visage du docteur Figgins sait « artistement mêler des plis propres à manifester tout ensemble la gravité, le blâme, le doigté et la compassion » ce qui en fait un comédien ; « Les yeux déjà globuleux du docteur Figgins s’ouvraient derrière ses lunettes dans des dimensions surprenantes. Douglas pensa : ‘‘ Il va les pondre ...’’ » ; les « cils blonds » de l’inspecteurBrown « papillotaient comme des mites ». L’humour, dès le début du récit repose sur les circonstances du crime qui dérogent à la logique pour créer des scènes à la limite de l’absurde comme lors du quiproquo entre les aveux d’un flegme britannique formulés par D. Templemore et les questions hébétées de l’inspecteur Brown : « Ah..., où est-elle [la mère] ? - On l’a ramenée hier au Zoo. - Elle est employée là-bas ? - Non. Elle est pensionnaire. ». C'est que Vercors entend réfléchir à l’humour : « ce n’est pas une façon de vous prédisposer à l’humour. » ; « eût ajouté pour nous [auteur et lecteurs] sans doute au comique de tous ces quiproquos ». Comique de mots aussi quand les journaux londoniens s’emparent du sujet : « Tropi or not tropi ». Jouant des formes comiques, l’auteur confine à l’humour noir lorsqu’il écrit « C’était d’ailleurs un tout petit cadavre », comme pour dévaloriser l’importance du cadavre, minimiser la gravité de la situation ; un autre exemple de cet humour noir se trouve dans l’épisode où des Papous mangent des tropis, des « Papous tropophages », ce qui pousse Pop Dillinghan, le prêtre, à se demander « pathétiquement s’il [doit] ou non confesser les Papous d’un péché mortel », celui de la « gourmandise ». L’humour prend également un ton quelque peu scabreux mais discret, quand l’auteur explique le retrait de Sybil parce que « certains signes trop manifestes montrèrent qu’il était sage qu’elle ne fréquentât point les tropis mâles sans nécessité absolue ».

L’humour est généralement au service d’une réflexion sur la nature humaine ; comme dans une fable ou l’idée est véhiculée de manière plaisante, Vercors use de l’humour sans perdre de vue son objectif : définir l’homme ; et c'est bien là l’enjeu du roman quels que soient les registres et les genres sollicités. Les animaux dénaturés est un roman philosophique qui pose le problème de la nature humaine dont les données sont complexes : D. Templemore a tué son fils ; celui-ci est un quadrumane (un singe ?) issu de l’insémination artificielle de la « tropiette » Derry ; sa mère, Derry, est d’ailleurs de forme simienne, un tropi c'est-à-dire un être à la frontière entre l’homme et le singe ; l’enfant, Garry Ralph Templemore, a été baptisé par un prêtre et a obtenu un état civil. Par conséquent, son meurtre en est-il vraiment un ? D. Templemore est-il réellement coupable ? La reconnaissance devant Dieu et la loi suffisent-elles à humaniser le nouveau-né ? Le problème et loin de s’arrêter là puisque cinq autres nouveaux-nés de même nature se trouvent au zoo et trente individus femelles semblables à la mère tropi sont en vie. Ce questionnement conduit au procès de D. Templemore qui va être jugé pour l’empoissonnement du nouveau-né : « le Paranthropus. C'est une espèce intermédiaire : homme ou singe ? Ils ressemblent aux deux. [...] A vous de faire la preuve du contraire, si vous pouvez. En attendant, son enfant est mon fils, devant Dieu et devant la loi. ». Deux parties s’affrontent : la défense va tenter de prouver que les tropis ressortent du monde animal ; l’accusation au contraire, va prouver que ces créatures appartiennent au genre humain. L’enjeu du procès repose sur l’accusation de D. Templemore qui seule empêchera des hommes comme Vancruysen de faire des tropis des animaux. La dimension philosophique se reconnaît aux chapeaux en tête des chapitres qui rappellent ceux que Voltaire avait inscrits dans Candide (1759) : les résumés transforment le récit en apologue.

La réflexion philosophique est perçue à travers le prisme des théories scientifiques, paléontologiques, zoologiques, anthropologiques, linguistiques et religieuses qui sont reproduites tout au long du roman, notamment, lors de l’expédition, dans l’observation des tropis ; et, plus particulièrement dans sa deuxième moitié occupée par le procès de Douglas Templemore. En Nouvelle-Guinée, les scientifiques sur place procèdent à une série d’expériences et d’analyses afin de déterminer le degré d’humanité des tropis : ainsi, ils découvrent que ces créatures se rapprochent de l’humain parce qu’ils enterrent leurs morts dans une nécropole, taillent la pierre pour fabriquer des coups-de-poing, communiquent par un langage fait de cris, font du feu. A ces considérations s’oppose l’objectivité des scientifiques qui n’excluent pas que certains insectes enterrent leurs morts, et que, tel que E. Benveniste le dira dans « Communication animale et langage humain » (In : Problèmes de linguistique générale, 1966), les animaux crient mais les cris ne sont pas un langage, que les animaux n’ont pas de « communication proprement linguistique » par laquelle un « savoir » serait transmis. Cette prudence frileuse est confortée par l’attitude de certains tropis dociles voire soumis « attirés avec du jambon [...] pour l’amour duquel ils avaient fini par abdiquer leur liberté », qui vivent heureux dans la « réserve » que les scientifiques leur ont construite, sans vouloir en sortir. Des tests d’intelligence peu concluants mettent en lumière que si les tropis produisent du feu avec des allumettes, « c'est toujours par hasard », que les quelques mots qu’ils sont capables de répéter n’excèdent pas en nombre, ni en difficulté ceux que des orangs-outangs reproduisaient dans une expérience du Dr. Furness en 1916, que la lettre « H » que certains peuvent écrire n’est qu’un moyen d’obtenir du jambon (« Ham » en anglais). Ainsi, les tropis réussissent-ils plus ou moins à imiter les gestes et les mots des hommes sans que leur mérite ne les y apparente pour autant ; on reconnaît ici la théorie des « animaux-machines » de R.-F. Descartes (Discours de la Méthode, 1637) selon laquelle le singe et le perroquet n’agissent que par réflexe, sans intelligence. Cette théorie est d’ailleurs visible dans l’industrie avec laquelle les tropis fabriquent leurs coups-de-poing : ils continuent d’en fabriquer bien que dans la réserve « ils n’aient plus jamais l’occasion de s’en servir », comme s’il s’agissait d’un héritage génétique. J. Rostand, dans Pensée d’un biologiste (1954) reprend cette idée (« La civilisation fourmi est inscrite dans les réflexes de l’insecte. La civilisation de l’homme ne réside pas dans l’homme ; elle est dans les bibliothèques, dans les musées et dans les codes ») pour distinguer l’animal de l’homme. En outre, les tropis savent rire et n’en déplaise à F. Rabelais (« le rire est le propre de l’homme », Gargantua, 1534), les chimpanzés en sont capables aussi. C'est peut-être la venue d’un « vieux tropis tout seul » dans le camp des expéditeurs qui change la perception que les scientifiques se font de ces créatures : il passe son coup-de-poing « sur sa poitrine velue, dans un geste de douceur pacifique » et fait preuve d’une « noblesse tranquille ». Il déambule avec « l’allure flâneuse, un peu distante, d’un visiteur à l’Exposition » de 1930 : on pense bien sûr à Cannibale (1988) de D. Daeninckx qui relate l’emprisonnement de Kanaks au zoo de Vincennes, sujets de curiosité pour les Parisiens ; or, ici, Vercors renverse la situation : ce sont les hommes, les scientifiques qui intriguent et que l’on vient voir ; les tropis s’en trouvent humanisés. Et, si la présentation des tropis l’amène à une évocation utopique de leur vie (« la vie dans les falaises était celle d’une communauté paisible, d’une démocratie plus que parfaite ») à la manière du mythe du « bon sauvage » de J.-J. Rousseau (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755 : « tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons, et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature »), c'est pourtant toujours l’idée de progrès qu’il défend comme dans sa préface à Pourquoi j’ai mangé mon père (1960) de Roy Lewis : « dès la plus petite découverte, la plus petite conquête sur la nature, [Edouard, le père de famille dans le récit de Roy] s'exclame comme un leitmotiv : ‘‘Les possibilités sont prodigieuses!’’ À croire qu'il pressent déjà qu'un jour, ajoutées l'une à l'autre, ces possibilités le mèneront sur la Lune. »

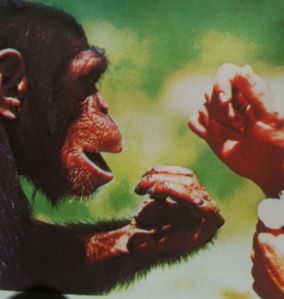

Malgré le caractère noble de certains tropis et les hésitations constantes des scientifiques, la menace pèse ; la question de leur humanité reste à prouver, ce que le procès rendra possible. La menace est celle d’une société régressive et comporte des aspects économiques, religieux et moraux. Sur le plan économique, un certain Vancruysen, voit dans la docilité des tropis une manne financière : ils pourraient être exploités au travail, « main-d’œuvre merveilleusement économique et soumise » ; ils savent imiter des gestes, ont des capacités importantes de travail ; ils peuvent être nourris et logés dans une réserve et reproduits comme du bétail en raison du rythme de la parturition chez les femelles que l’on peut accroître. Ce Vancruysen rappelle le Vanderdendur dans Candide (1759) ; le négociant en sucre devient celui en laine. Il a l’idée d’impliquer les banques australiennes qui par leur crédit se trouvent engagées « jusqu’au cou » ; en cas de procès, il serait peu plausible qu’on fasse s’écrouler les banques et du même coup le système économique. Du point de vue religieux, celui du bénédictin Pop Dillighan, les tropis doivent être baptisés ; sans cela, leur âme – si tant est qu’elle existe – est condamnée à errer dans les Limbes. C'est un souci continuel chez lui, qui se trouve augmenté par la fragilité de leur constitution (ils « semblaient mourir avec une assez grande facilité, à des âges divers »), et surtout quand des Papous, à la suite d’une querelle, en font des rôtis. Les tropis vivent instinctivement et sans tabous. « Faut-il les abandonner dans l’innocence ? Mais s’y trouvent-ils seulement ? S’ils sont hommes, ils sont pêcheurs : et ils n’ont point reçu de sacrement ! Doit-on les laisser vivre et mourir sans baptême, avec tout ce qui les attend au-delà, ou bien… » ; le père Dillighan incarne ici le missionnaire qui lors des colonisations convertissait les indigènes à la foi chrétienne ; christianisation que les Papous ont eux-mêmes connue ; on se représente sans peine l’embarras du prêtre quand les Papous mangent les tropis ! Historiquement, la conversion de peuplades dites « primitives » à la religion chrétienne pose un problème moral ; c'est de ce problème qu’il est finalement question : la découverte des tropis provoque une remise en cause de l’humanité du « Pygmée d’Afrique, [du]Veddah de Ceylan ou [du] Tasmanien » par la redéfinition de l’homme qu’elle implique ; en effet, selon Julius Drexler, un anthropologue, fervent opposant de Vancruysen, l’« apparition des tropis [...] prouve l’inanité de la notion simpliste de l’unicité de l’espèce humaine. Il n’y a pas d’espèce humaine, il n’y a qu’une vaste famille d’hominidés [...] au sommet de laquelle est le Blanc –l’homme véritable- pour aboutir, à l’autre bout, au tropi et au chimpanzé » ; l’intérêt « vénal » de Drexler qui veut ruiner l’entreprise de Vancruysen en « faisant subtilement mettre en doute [...] la nature animale des tropis », conduit à une théorie raciste qui entraîne une hiérarchisation des hommes ; théorie dont s’emparent bientôt les journaux de l’Afrique du Sud, où règne l’apartheid, pour poser la question : « Les nègres sont-ils des hommes ? ». Quelques années après la seconde guerre mondiale, ce problème moral tel qu’il est présenté dans le roman, fait écho au nazisme ; d’ailleurs, paradoxalement, le père Dillighan ne dit-il pas qu’il se ferait « l’idée d’un nazi qui fête Noël en famille et se réjouit des camps de concentration », s’il laissait l’âme des tropis errer et brûler aux enfers.

Face à une situation si inquiétante, alourdie par le poids de la mémoire, le procès acquiert toute sa valeur ; il officialise la définition de l’homme et le problème soulevé par l’existence des tropis. Les parties vont s’évertuer à prouver l’animalité ou l’humanité des tropis : à l’aspect physique proche de l’humain chez les femelles et les nourrissons, s’opposent la disproportion de leurs membres et le caractère simien des pieds et des mains. L’insémination de la femelle tropi attesterait du caractère humain des tropis qui appartiendrait à une même espèce ; mais, c'est également le cas avec le chimpanzé ou l’orang-outan. Le scientifique Knaatsch appelé à témoigner, considère les tropis comme des hommes puisqu’ils ont un astragale qui leur permet de rester debout ; par ailleurs, ils taillent la pierre et font du feu ; en revanche, le professeur Eatons s’oppose aux théories évolutionnistes de Lamarck, relayées par Knaatsch, qui sous-tendent un rapport entre le pied de l’homme et celui du singe ; d’office, le tropi a un pied de singe quand l’homme n’en aurait jamais eu. Puis, il reprend les propos de Drexler en s’appuyant sur une définition étriquée de l’homme (1065 caractères anatomiques dont deux tiers communs à l’homme). Enfin, le professeur Rambole avance l’idée que seul, le langage ne suffit pas à caractériser l’homme, mais le besoin qu’il a d’en user. Il croit également en la valeur proprement humaine des « gris-gris » qui font de l’homme un animal métaphysique qui se pose des questions. A ce dernier, le professeur Thropp rétorque : « Pourquoi voudriez-vous que mes braves chimpanzés se posent des questions stupides ? Des gris-gris ? ». Seule la définition de l’homme assimilé à un « animal dénaturé », celle à laquelle le juge Draper parvient en discutant avec son épouse, paraît finalement satisfaisante et permettrait d’en rapprocher le tropi : l’homme est celui qui réussit à s’arracher à la nature : « L’animal fait un avec la nature. L’homme fait deux. Pour passer de l’inconscience passive à la conscience interrogative, il a fallu ce schisme, ce divorce, il a fallu cet arrachement. N’est-ce point la frontière justement ? Animal avant l’arrachement, homme après lui ? Des animaux dénaturés, voilà ce que nous sommes. » Cela revient à considérer la culture comme le fondement de l’humanité. En d’autres termes, en menant une réflexion sur ce qui définit l’homme, le roman progresse vers une réflexion sur la culture.
Qu’est-ce que la culture ? C'est la question à laquelle l’ethnologue et écrivain Michel Leiris se propose de répondre dans Cinq études d’ethnologie (parues en 1969 ; reprise partielle du Racisme devant la science, 1960) : l’homme se définit par sa culture (« L’homme à l’état de nature est, en vérité, une pure vue de l’esprit ») ; et, comme chez S. de Beauvoir (« on ne naît pas femme, on le devient », Le deuxième Sexe, 1949), on devient homme ; c'est d’ailleurs ce que suggère l’ « arrachement » qui est exprimé dans Les animaux dénaturés : « l’humanité n’est pas un état à subir. C'est une dignité à conquérir. » Selon, M. Leiris, l’homme thésaurise, c'est-à-dire qu’il accumule les savoirs pour les utiliser ; la culture se définit par le fait de mettre « en jeu des artifices tels que la parole », par l’aptitude « à symboliser, c'est-à-dire user des choses en leur attribuant un sens conventionnel » (sorte d’ « héritage social ») ; elle « comprend tout ce qui est socialement hérité » comme « les croyances, connaissances, sentiments, littérature », le langage, les gestes, les « types d’habitation ou de vêtements, outillage, objets fabriqués et objets d’art ». La culture pourrait bien se résumer au paradigme croyance-savoir-savoir-faire mais « son domaine englobe les ordres de fait les plus différents » et s’inscrit dans un « vaste ensemble ». Albert Jacquard identifie la source de la culture dans « La voie de la culture » (Courrier de l’Unesco) : « La culture c'est ce moyen que nous avons, nous les hommes, de construire des hommes. La nature a fait Homo et Homos’est trouvé capable de construire Sapiens et nous avons inventé la science, et nous avons regardé le monde autrement...et nous avons inventé la beauté et nous avons inventé des exigences aussi extraordinaires que l’exigence d’égalité ou l’exigence de justice. » La beauté, la justice, l’égalité contribuent à la culture en ce qu’elles entrent dans le cadre des inventions humaines ; il n’y a rien de beau sans un regard pour trouver quelque chose de beau. Par ailleurs, l’auteur insiste sur la responsabilité de l’homme qui est à la source de la culture : « la société du 21e siècle ce sont eux [les étudiants de Jacquard] qui la feront. Elle est à faire et la science nous dit que c'est ça LA CULTURE. » La culture est l’aptitude à choisir la civilisation à venir, c'est créer un devenir.
Le lecteur est invité à réfléchir à la question de l’Autre, à la définition de l’homme et conséquemment à celle de la culture comme dans Cannibale (1998) de Daeninckx, Pourquoi j’ai mangé mon père (1960) de Roy Lewis ou Le Singe nu (1968) de Desmond Morris. Plus généralement, cette réflexion s’inscrit dans celle de Montaigne (« Des cannibales », Les Essais, 1588-1592), de Rousseau (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, en 1755) de Voltaire (Candide, 1759), et de Diderot (Supplément au voyage de Bougainville, 1773) en ce qu’elle est relative à la question de l’altérité et de l’ethnocentrisme. C'est à cette illusion ethnocentrique que l’essai de Claude Lévi-Strauss (« Race et Histoire », in Anthropologie structurale II, 1952) s’oppose : les hommes, les Européens puis les Occidentaux pour tout dire, ont cette fâcheuse tendance à croire que leur propre culture est un repère unique ce qui les conduit à hiérarchiser et à rejeter hors de l’humanité les formes culturelles différentes. Cette réflexion sur l’homme, Vercors la génère également dans Sylva (1961) un autre roman philosophique, ainsi que dans la réécriture de Les animaux dénaturés en Zoo ou l’Assassin philanthrope (1964). Dès l’épigraphe des Animaux dénaturés (« ‘‘Tous nos malheurs proviennent de ce que les hommes ne savent pas ce qu’ils sont, et ne s’accordent pas sur ce qu’ils veulent être.’’ D. M. TEMPLEMORE (Plus ou moins bêtes) »), le ton est donné : la définition de l’homme s’impose d’autant plus qu’elle manque de clarté, ce qui est à l’origine de problèmes tels que le racisme et l’esclavage. Le terme « bêtes » offre un clé du roman : les hommes sont assez dépourvus de raison pour réduire leur définition de l’homme à ce qu’ils connaissent ; ce sont en tout cas, des animaux, ces « animaux dénaturés » ainsi que les appelle le juge Draper, lors du procès. Cette réflexion prend tout son sens quand on situe l’œuvre dans le temps : Les animaux dénaturés paraît dans la période d’après-guerre et fait le bilan des atrocités perpétuées dans les camps. Dans une présentation de « Vercors par lui-même » (Le Dictionnaire : littérature française contemporaine, 1988 ; Dictionnaire des écrivains contemporains de langue française : par eux-mêmes, 2004), l’écrivain s’élève contre la « bande de criminels [d’Hitler] et leurs abominables aberrations » et « leur doctrine appuyée sur Darwin » ; il préconise « une réfutation objective, irréductiblement fondée sur ce fait : l'espèce humaine. Sur ce qui la distingue spécifiquement de toute la Création. » pour parvenir à une définition de l’homme : « seul l'homme refuse de subir la domination aveugle de la Nature, à quoi toute bête obéit sans broncher. »
Si vous voulez en savoir plus sur Vercors
http://vercorsecrivain.pagesperso-orange.fr/
ET sur les théories ainsi que sur les impostures scientifiques
http://www.hominides.com/html/theories/theories.php
Pour découvrir une étude philosophique de Les animaux dénaturés
http://www.implications-philosophiques.org/litterature/les-animaux-denatures-vercors/problematique/

Serge Reggiani, « L'Homme fossile » (1968)
V’là trois millions d'années que j’dormais dans la tourbe
Quand un méchant coup d’pioch’ me trancha net le col
Et m’ fit effectuer une gracieuse courbe
A la fin d’ laquelle je plongeai dans l’formol
D'abord on a voulu m’consolider la face
On se mit à m’brosser mâchoire et temporal
Suivit un shampooing au bichromat’ de potasse
Puis on noua un’ faveur autour d’ mon pariétal
Du jour au lendemain je devins un’ vedette
Journaux télévision y'en avait que pour moi
Tant et si bien du rest’ que les autres squelettes
Se jugeant délaissés me battaient un peu froid
Enfin les scientifiqu’s suivant coutumes et us
Voulant me baptiser de par un nom latin
M'ont appelé Pithécanthropus Erectus
Erectus ça m’ va bien moi qu'étais chaud lapin
Et ces messieurs savants à bottin’s et pinc’-nez
Sur le vu d'un p’tit os ou d'une prémolaire
Comprirent que j’possédais de sacrées facultés
Qui me différenciaient des autres mammifères
Ils ont dit que j'étais un virtuos’ du gourdin
Qui assommait bisons aurochs et bonn’ fortune
Que j'étais drôl’ment doué pour les petits dessins
De Vénus Callipyge aux tétons comm’ la lune
Ils ont dit que j’ vivais jadis dans une grotte
Ils ont dit tell’ment d’choses tell’ment d’ trucs curieux
Qu’ j'étais couvert de poils et qu’ j'avais pas d’ culotte
Alors que j'habitais un pavillon d’ banlieue
J'étais comm’ tout le mond’ pétri de bonn’s manières
Tous les dimanch’ matins je jouais au tiercé
Je portais des cols durs et des bandag’s herniaires
C'était avant la guerre avant qu’tout ait sauté
C'était voilà maint’nant bien trois millions d'années
Vous n'avez rien à craindre y'a plus de retombées



/idata%2F1365978%2F%2Fs.jpg)
/idata%2F1365978%2F%2Fakhenaton.jpg)
/idata%2F1365978%2F%2Ftomte.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)